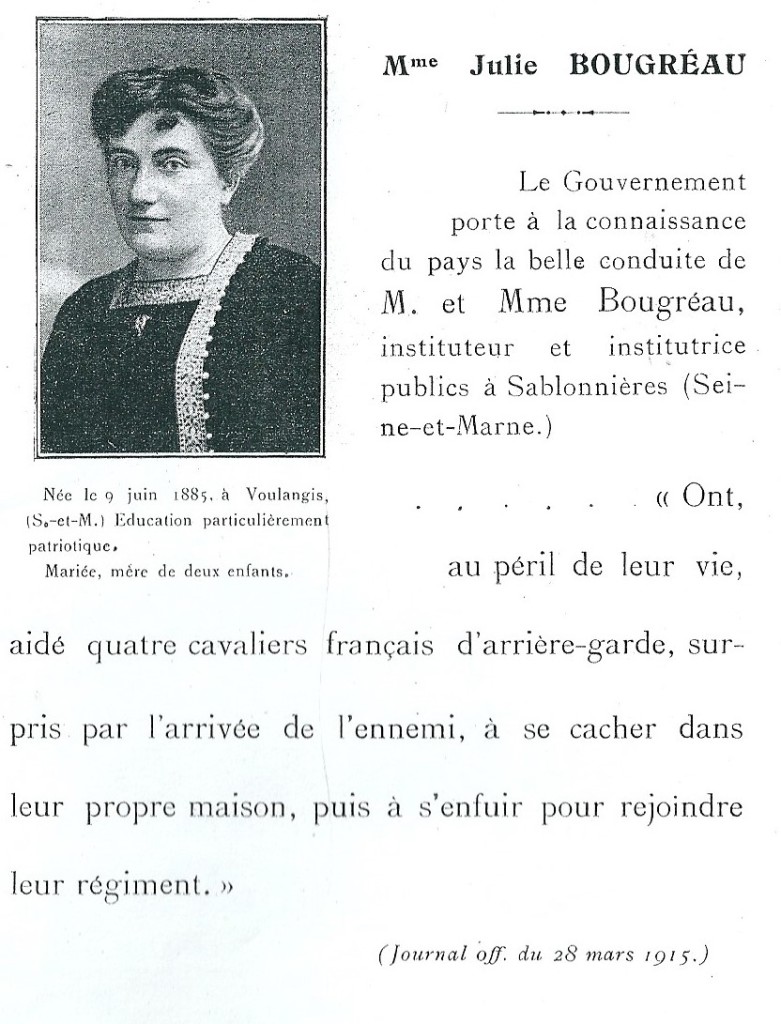Un après-midi d’octobre l’historienne Chantal Antier reçoit notre équipe de rédaction chez elle à Avon. Si nos entretiens cherchent à éveiller le désir de nouvelles lectures par la découverte d’un auteur ou d’un acteur du monde littéraire, cette rencontre nous aura permis de réfléchir sur le sujet de ses dernières recherches : les Femmes dans la Grande Guerre 1914-1918.

La Grappe : Chantal Antier, merci de nous recevoir et d’accepter cet entretien pour les lecteurs de La Grappe.
Quelle a été votre motivation personnelle pour entreprendre cette recherche sur la vie des femmes pendant la première guerre mondiale et sa place dans votre parcours d’historienne ?
Chantal Antier : Je n’avais pas du tout l’intention de travailler sur la Grande Guerre, je voulais travailler sur le Moyen-âge ! Voyez le rapport ! Reprenant l’enseignement après la naissance de mes enfants, j’ai voulu suivre des cours en faculté. Mais il n’y avait pas de place dans ce que je voulais faire. J’avais ma licence. Pour faire une maîtrise, on m’a autorisée, à prendre les cours donnés à Vincennes le lundi matin à des militaires. Et le cours était sur la guerre de 1914. J’ai trouvé ça intéressant et dans le même temps mon père est décédé, il avait très peu parlé de cette guerre qu’il avait faite. J’ai trouvé comme tout un chacun des souvenirs, des photos et j’ai su qu’il avait été blessé, ce que j’ignorais. Les deux choses conjointement, mon professeur me propose de faire une recherche sur la guerre de 14 en Seine-et-Marne parce qu’il n’y avait rien eu de fait sur la question. J’ai eu la surprise de trouver énormément de documents aux Archives de Seine-et-Marne. J’y passais mes mercredis et allais à Paris quand il manquait des renseignements. J’ai vu ce département vivre la guerre à travers les gens dans leur village et donc je l’ai sillonné pour voir à quoi ça ressemblait et rencontrer sur place ceux qui s’y intéressaient.
PARCOURS DE L’HISTORIENNE : DE LA THÈSE AU PREMIER LIVRE
La Grappe : Comment êtes-vous passée des études à l’écriture de livres ?
Chantal Antier : Je croyais en avoir terminé avec ma maîtrise mais on m’a demandé de préparer une thèse que j’ai soutenue et ça a marché. Je comptais m’arrêter là, mais un éditeur m’a proposé d’en faire un livre facile à lire. Ça a été La Grande Guerre en Seine et Marne 1914-1918. Ensuite, j’ai écrit des articles pour des revues, pour 14-18 Magazine.
A partir des archives personnelles de mon père qui avait dirigé des tirailleurs algériens pendant la guerre, j’ai écrit un livre sur les soldats des colonies. Je suis la seule femme d’ailleurs à avoir écrit sur le sujet. Et puis, je me suis dit : s’il y a des hommes des colonies, il y a bien des femmes des colonies et personne n’en parle. Pourtant, certaines sont venues en France et ont dû vivre dans des conditions difficiles. Récemment, dans le midi, comme j’en parlais, quelqu’un m’a dit qu’à Toulon, il y avait eu un camp d’Algériens, d’Indochinois et de Chinois et qu’on avait édifié des mosquées pour les uns, des pagodes pour les autres. Et il n’en reste rien, que des traces dans les archives. Il ne faudrait pas laisser perdre ça et faire des recherches ! Ces soldats qui se sont battus avec nous, on ne les a pas toujours bien considérés. A la fin, ils n’ont pas touché de retraites. Il faut imaginer comment les femmes ont pu récupérer leurs maris qui avaient vécu quatre ans avec des Français et qui rentraient dans leurs villages très pauvres. On s’aperçoit qu’il y a beaucoup de sujets qu’on peut encore étudier.
L’HISTORIENNE ET LES FEMMES
La Grappe : Et votre recherche sur les femmes en France dans tout ça ?
Chantal Antier : J’ai continué sur la guerre de 14, on parlait beaucoup des intendants militaires qui étaient chargés de diriger les agricultrices et de vérifier le sérieux de leur travail, les surveiller et leur fixer chaque année des objectifs de production de blé, de fruits, de volailles. Et donc ces femmes qui savaient souvent à peine lire et écrire ont dû apprendre très vite et moi, ça m’a stupéfiée d’admiration. Et dans les usines d’armement, ces femmes qui travaillaient avant dans le textile, à la chocolaterie Menier à Noisiel ou dans les emballages à Champagne sur Seine, comment ont-elles fait pour s’adapter sans formation ? Même si au début de la guerre il y avait encore des ouvriers et en 1915 des permissionnaires pour mettre en route les travaux avec elles. D’ailleurs, on ne croyait pas du tout qu’elles en seraient capables, les directeurs d’usines n’avaient pas envie de les prendre dans ces domaines-là.
La Grappe : Comment se débrouillaient-elles dans ces conditions ?
Chantal Antier : Elles n’étaient pas protégées du tout, ni gants, ni masques. Combien y-en-a-t-il qui ont eu les mains coupées, qui ont été victimes des acides ? L’allocation pour celles qui avaient un mari soldat était si maigre qu’il fallait bien qu’elles travaillent ; leur seul choix, c’était l’agriculture ou l’usine.
C’est une époque où les gens vivaient en famille avec les grands-parents qui les aidaient autant que les enfants, et je regrette qu’on n’ait pas écrit grand chose sur les enfants… parce qu’on n’est pas allé très loin sur les recherches sur les enfants. Et pourtant ! Là, j’ai découvert dans les archives des institutrices qui racontaient les dictées qu’elles faisaient faire. Pouh ! C’était sur la guerre, tout était sur la guerre, elles faisaient écrire des rédactions aux enfants, comme « Vous racontez le retour de votre père blessé à la guerre, quelles sont vos réactions ? Imaginez ». Oui, je pense qu’on n’imagine absolument pas cette France patriote de l’époque formée dans l’école de la République puisqu’on apprenait avec des fusils en bois comment on devait tirer, etc, ça allait avec les cours de gymnastique dans toutes les écoles de Seine-et-Marne comme ailleurs.
Et puis, tout était axé pour soutenir « nos pauvres soldats ».
La Grappe : On encourageait la population à se priver pour les soldats ?
Chantal Antier : On transportait des vivres au front, il y avait entre autres l’Association du Pain de Fontainebleau qui faisait des pains en quantité qu’on leur apportait. Mais le temps qu’ils arrivent, les pains étaient abîmés alors ils leur ont écrit : « N’en envoyez pas, il est pourri, c’est horrible de voir du pain ainsi, nous qui attendions ça ! ».
La Grappe : Est-il vrai que des Françaises ont demandé à combattre aux côtés des hommes sur le front ?
Chantal Antier : En 1915, j’ai trouvé que des Belges et des Françaises avaient demandé à être mobilisées comme les soldats. Tout le monde a bien ri, le gouvernement aussi bien belge que français, ce n’était pas dans les habitudes. Et puis il faut penser qu’à ce moment-là, la femme considérée comme celle qui fait les enfants, doit donc être protégée ; pendant ce temps l’Allemagne accordait des droits à ses ouvrières.
La Grappe : On sent que l’historienne que vous êtes ressent l’ambiance d’une époque et cherche à comprendre comment les gens pensaient à ce moment-là.
Chantal Antier : Oui, cette guerre, cela fait longtemps que j’y travaille, beaucoup de gens m’ont parlé de leurs parents, de leurs grands-parents. Et puis, j’ai heureusement la chance d’avoir un peu d’imagination. En lisant les archives, j’arrive quelquefois à visualiser. J’ai une amie qui me suit dans mes conférences et me dit : « C’est drôle, tu ne fais jamais la même conférence ! Au moment où tu parles, il nous vient des images. ». Je crois que je ne suis pas une « vraie thésarde » comme on dit. J’ai eu le temps de vivre avant, j’ai eu mes enfants. Ça vous change la manière de concevoir les choses.
L’HISTORIENNE CONTEUSE
La Grappe : Vos livres sont d’une lecture très accessible, nous dirions que ce sont des ouvrages savants tournés vers un public non spécialisé : l’historienne est-elle aussi une conteuse ?
Chantal Antier : Ah oui, quand j’écris je pense beaucoup aux gens autour de moi parce que ma famille lit mes livres. Même mes petits-enfants, ça c’est sympa, ce regard des plus jeunes et puis des gens de mon âge, je leur demande qu’ils me disent la vérité sur ce qu’ils en pensent, sinon cela ne me sert à rien.
L’HISTORIENNE ET LES ARCHIVES
La Grappe : Comment avez-vous travaillé, quelles ont été vos sources ?
Chantal Antier : Les archives départementales par exemple m’ont permis d’accéder à la liste des usines en Seine-et-Marne. Mais j’ai aussi consulté les archives militaires de Vincennes et des archives privées. Maintenant la plupart des archives sont numérisées, ce qui n’était pas le cas à l’époque de ma thèse. C’est une bonne chose mais on peut regretter de perdre le contact avec l’archive. Il y a des historiens qui ne se basent pas du tout sur les archives, ils se servent des journaux…et d’après les journaux de la guerre de quatorze on était gagnants à toutes les batailles ! Les journaux c’est facile à lire et à retrouver, les archives ça demande du temps pour dépiauter des kilos de feuilles pour trouver la pépite, mais c’est ça qui est intéressant !
La Grappe : Comment avez-vous eu accès aux informations sur Marie-Julienne Jonot, exploitante d’une laiterie1 à Rubelles ou Marie-Louise de Prat, directrice de l’hôpital militaire de Montereau ?
Chantal Antier : Justement ce n’est pas vieux, c’est en parlant aux uns et aux autres à propos du Centenaire. Je saisis tout de suite s’il y a quelque chose qui peut se rapporter à des faits, et en questionnant les gens…et les gens me disent rarement non. Donc, pour les femmes ce sont surtout les archives d’abord. Après dans les villages où on m’a demandé des conférences sur la guerre, j’ai essayé de parler aux gens, de voir s’ils avaient des souvenirs de leurs grands parents…
La Grappe : L’histoire de Marie-Louise de Prat ne vous a-t-elle pas permis de faire un scoop historique ?
Chantal Antier : Oui l’affaire Marie Curie !! On ne voulait pas me croire, je savais que Marie Curie était venue faire ses premiers essais à l’hôpital militaire de Montereau. On m’a dit : « ce n’est pas possible, on n’en a aucune connaissance… ». Je n’avais pas rêvé, mais je ne me rappelais pas où je l’avais trouvé, ni où j’avais classé cette note. Et puis, coup de chance, dans notre exposition qui sera à l’Astrolabe de Melun en novembre, on cite cet hôpital de Montereau. Alors je dis que j’aimerais bien qu’on parle de Marie Curie, et on me répond : « Oui, mais vous n’en êtes pas sûre ».
La Grappe : Là l’historienne intervient car il faut retrouver la preuve !
Chantal Antier : Oui, donc je me suis adressée au Musée Marie Curie à une charmante jeune femme qui venait d’écrire un livre sur elle et je lui pose cette question à laquelle personne ne croit. Elle me confirme : « Mais bien sûr, elle y était avec sa fille Irène et elle a fait ses premières radios sur des blessés de la bataille de la Marne … ».
La Grappe : Et donc Marie Curie est bien venue faire ses premiers essais d’examen radiologique à Montereau ! Ce n’est pas banal.
Chantal Antier : C’est intéressant. Mais c’est horrible, la façon dont c’est raconté, comment on a ramené ces blessés dans des trains, des voitures à cheval depuis le champ de Bataille de la Marne jusqu’à Montereau, les pauvres étaient morts pour la plupart avant d’arriver.
L’HISTORIENNE, LE NORD ET LE SUD
La Grappe : En étudiant les archives concernant l’ensemble du territoire seine-et-marnais en guerre, avez-vous remarqué des particularités entre le nord et le sud ?
Chantal Antier : Le nord en grande partie était toujours en guerre, le sud lui avait beaucoup d’hôpitaux et d’exploitations agricoles en état… mais le sud n’est vraiment pas considéré par les historiens. Le nord du département ne portant pas d’intérêt pour le sud, je leur dis : « N’oubliez pas que si on ne vous avait pas soignés, si on ne vous avait pas apporté du pain et les produits agricoles, vous croyez que le nord aurait tenu toute la guerre ? ». Là, personne ne me répond…! Nous avions donc des hôpitaux organisés : Fontainebleau, Avon, Samois. Dans beaucoup de villages, les petits hôpitaux dits supplémentaires, c’était des gens qui offraient leur maison, leurs belles propriétés. Tous les châteaux étaient réquisitionnés. Les femmes de la haute société ont servi comme infirmières dans leurs châteaux : ceux-ci ont été laissés dans un état épouvantable sans compensation. Il y en a qui ont vraiment tout perdu.
On oublie qu’il y avait un “consensus” comme dit un historien. Tout le monde est touché par la guerre, c’est la première fois que du haut en bas d’une société, on se mobilise. Toutes les familles se sont impliquées. Les marraines de guerre passaient du temps à envoyer des lettres, des paquets et recevaient les permissionnaires parce que certains soldats n’avaient plus de parents. Sans compter tous ces gens du nord en exode venus se réfugier ici.
La Grappe : On parle de la zone occupée de la guerre de 1940 mais pas de celle occupée en 1914.
Chantal Antier : On commence à en parler maintenant que des gens donnent leurs archives familiales et déposent des lettres aux archives départementales, ça c’est une bonne chose. Moi je n’avais rien sur des zones occupées, des villages massacrés par les allemands. A présent, il y a des chercheurs et parmi eux des femmes qui se lancent dans cette recherche et rapportent des faits impressionnants.
C’est une guerre horrible, plus on l’étudie, plus on le sait, … Je n’aurais jamais pensé si j’avais vécu en 1914 qu’il y en aurait une seconde si près, vingt ans après.
L’HISTORIENNE ET TOUJOURS LES FEMMES
Chantal Antier : Les femmes dans la guerre de « 14 », je n’étais pas partie pour les admirer mais je trouve quand même qu’elles ont fait beaucoup, surtout dans les champs, elles n’avaient pas de chevaux, pas de matériel comme il y en a eu après grâce aux Etats Unis. Elles avaient pour les aider, ça aussi je l’ai découvert dans les archives, des prisonniers allemands d’un grand centre de Montargis. Malheureusement ils n’ont plus les archives, transmises peut-être aux archives militaires de Vincennes. J’ai demandé à les consulter, pour l’instant je n’ai pas trouvé… et donc on envoyait en Seine-et-Marne des groupes de prisonniers, on demandait aux civils plus âgés qui ne pouvaient pas partir à la guerre de les surveiller. Sauf qu’à la fin de la guerre, ceux-là aussi sont partis. Comme il n’y avait plus personne pour surveiller les prisonniers, chaque fois que le front se rapprochait de la Marne, ils désertaient et arrivaient à repasser les lignes côté allemand. Donc les pauvres femmes n’avaient plus personne pour le travail.
Et puis il y a eu ici des gens des colonies, il n’en reste pas grand-chose non plus dans les archives, des Chinois dans la forêt de Fontainebleau qui coupaient du bois pour réparer les voies ferrées, des travailleurs algériens et tunisiens. Certains ont demandé à apprendre le français ; des villages ont demandé à des institutrices de leur donner des cours du soir que la mairie payait. Ces gens, après avoir travaillé dans les champs dans des conditions difficiles, voulaient encore s’instruire.
L’HISTORIENNE ET L’ECRITURE
La Grappe : La Grappe s’intéresse aux écritures contemporaines : quelles sont les spécificités de l’écriture historique d’aujourd’hui ? D’où parle finalement l’historienne quand elle relate l’histoire des femmes d’il y a 100 ans ?
Chantal Antier : On ne disait pas aux jeunes historiens faisant une thèse comment mettre les notes, la théorie en forme : je me suis débrouillée seule. Ce n’est pas du tout la même écriture que pour écrire un roman, ou un essai, sans arrêt il faut se dire « D’où j’ai tiré ça ? Qu’est-ce que j’ai fait de ça ? Bien noter ça… ».
La Grappe : Donc l’historienne a une méthodologie très rigoureuse ?
Chantal Antier : Une méthodologie très difficile à maîtriser et à tenir sur plusieurs années, le temps des recherches. L’écriture par contre c’est différent, on écrit parce qu’on a envie de dire quelque chose, ce n’est pas plus facile. Il faut lire, relire, faire attention à ne pas dire de choses qui ne sont pas vraies. Là aussi, cela dépend beaucoup de la manière dont vous êtes pris en compte par l’éditeur. Et parfois j’ai eu des déboires considérables avec certains d’entre eux. En fait, il y a deux sortes d’écriture : l’écriture universitaire pour les maîtrises, pour les thèses et l’écriture pour le lecteur. Ça c’est vraiment ce que je préfère, écrire pour un plus grand public que les spécialistes. C’est différent et c’est un travail de très longue haleine. J’admire les auteurs qui écrivent un livre chaque année. Moi j’en ai écrit cinq, je trouve que c’est pas mal. Mais là j’arrête…j’ai dit « c’est terminé ». C’est très fatigant.
La Grappe : Vous pensez à Max Gallo, non, peut-être ?
Chantal Antier : Mais il a des livres qui ne sont pas mal.
La Grappe : C’est l’armistice alors ?
Chantal Antier : Exactement. Et puis, on peut écrire toutes sortes de livres.
Entretien réalisé par l’équipe de rédaction avec le concours de Sandra Sozuan.